Savez‑vous que près d’un tiers des missions courtes en entreprise sont gérées via des solutions tierces, avec des cadres juridiques très différents ? Ce chiffre illustre l’impact réel des choix de contrat sur la gestion des ressources humaines et sur la carrière des professionnels.
Dans cet article, nous clarifions les logiques qui séparent ces deux modes d’emploi tripartite. L’un repose sur un contrat de mission et une mise à disposition, l’autre sur un contrat de travail chez une société intermédiaire associé à une prestation commerciale.
Vous découvrirez quand privilégier l’option adaptée aux prestations intellectuelles, aux besoins de remplacement ou aux impératifs budgétaires de votre entreprise. Nous détaillons aussi durées, qualifications requises, exclusions d’activités, et les impacts sur la rémunération et la protection sociale.
Pour approfondir la comparaison légale et les cas d’usage concrets, consultez notre guide complet : différence entre portage salarial et intérim.
Table of Contents
Points clés à retenir
- Cadres contractuels distincts : mission + mise à disposition vs contrat de travail + prestation commerciale.
- Usage : mission courte ou saisonnière pour l’un, prestation autonome et intellectuelle pour l’autre.
- Durées et qualifications : limites légales et exigences de diplôme ou d’expérience.
- Rémunération et avantages : prime de précarité, égalité de traitement et protection sociale.
- Impact financier : coûts pour l’entreprise et frais de gestion à comparer selon le besoin.
Comprendre les bases avant de comparer
Avant de comparer les formules, clarifions d’abord qui prend la mission et comment se formalise le contrat.
Les deux dispositifs donnent accès au statut de salarié, mais ils diffèrent sur le modèle commercial et la prospection.
- Travail temporaire : le salarié signe un contrat de mission avec une agence. L’agence place la personne chez une entreprise cliente et veille à l’égalité de traitement (salaire, avantages).
- Société de portage : elle assume l’administratif, le juridique et la facturation. Le professionnel trouve sa mission, négocie son tarif et signe un contrat travail (CDD ou CDI) avec la société. Un contrat commercial lie ensuite la société à l’entreprise cliente.
Le cadre change aussi selon le niveau d’autonomie requis. Le portage cible surtout des prestations intellectuelles avec une qualification minimale. Le travail temporaire sert davantage les besoins de remplacement ou d’activité saisonnière.
Comprendre ces bases vous aidera à suivre la suite de cet article et à identifier qui organise la mission, qui fixe les conditions, et comment s’articulent les responsabilités.
Pour un comparatif portage salarial et intérim, poursuivez la lecture.
Définitions et cadre légal : portage salarial et travail temporaire

Commençons par définir les contrats et les limites légales qui encadrent ces deux solutions. Cette précision vous aide à choisir selon la nature de la mission.
Qu’est-ce que le travail temporaire et son contrat de mission
Le travail temporaire repose sur deux contrats distincts. L’intérimaire signe un contrat de mission avec l’agence. L’agence conclut une mise à disposition avec l’entreprise cliente.
Les motifs légaux incluent le remplacement d’un salarié absent, un accroissement d’activité ou un poste saisonnier. L’égalité de traitement impose salaire et avantages équivalents. Une prime de précarité d’environ 10% complète le salaire à la fin du contrat.
Qu’est-ce que le portage salarial et le rôle de la société de portage
Le portage salarial combine un contrat travail (CDD ou CDI) avec une société dédiée et un contrat commercial entre cette société et l’entreprise cliente.
Cette formule vise surtout des activités intellectuelles, exigeant une qualification minimale et une autonomie du salarié porté. Certaines activités (services à la personne, BTP) sont exclues.
La relation tripartite et durées maximales
Les deux systèmes sont tripartites mais diffèrent juridiquement. En intérim, la subordination opérationnelle se ressent dans l’entreprise cliente. En portage, l’accompagnement vient de la société sans subordination dans l’exécution.
Les durées maximales varient : le portage plafonne la mission à 36 mois. L’intérim obéit à des plafonds spécifiques selon la disposition : 9, 18, 24 ou 36 mois selon le motif.
| Élément | Travail temporaire | Portage salarial |
|---|---|---|
| Contrats | Contrat de mission + mise à disposition | Contrat travail (CDD/CDI) + contrat commercial |
| Motifs | Remplacement, accroissement, saison | Prestations intellectuelles, conseil |
| Durée maximale | 9 / 18 / 24 / 36 mois selon disposition | 36 mois |
| Avantages sociaux | Égalité de traitement + prime de précarité | Protection sociale via le contrat travail |
| Activités exclues | Peu d’exclusions spécifiques | Services à la personne, BTP, etc. |
La différence entre portage salarial et intérim
Examinons comment statut, autonomie et grille salariale façonnent le quotidien du professionnel.
Statut, lien de subordination et autonomie au quotidien
En intérim, le lien subordination se manifeste chaque jour : horaires, process et reporting suivent la logique de l’entreprise cliente. L’intérimaire travaille sous management de proximité.
En portage salarial, il n’y a pas de subordination opérationnelle. Le salarié porté conserve une grande autonomie d’organisation et pilote ses méthodes selon des objectifs convenus.
Rémunération, grille salariale et négociation du taux journalier
La rémunération diffère nettement. L’intérimaire suit la grille interne liée au poste et aux qualifications.
Le salarié porté négocie son TJM librement avec la société qui facture l’entreprise. Cette souplesse reflète la valeur du service sur le marché.
Contrats en présence
Les contrats confirment ces logiques : contrat de mission et mise à disposition pour l’intérim ; contrat de travail avec la société et contrat commercial pour le portage.
Avantages sociaux, prime de précarité et accès aux avantages d’entreprise
En intérim, l’égalité de traitement s’applique : titres-restaurant ou chèques vacances peuvent être accessibles. Une prime de précarité d’environ 10% intervient à la fin de la mission.
En portage, le salarié reste sous protection sociale via la société. Toutefois, l’accès aux avantages de l’entreprise cliente n’est pas systématique.
« Le choix tient souvent à votre besoin de cadre hiérarchique ou de liberté commerciale. »
- Contrôle opérationnel : intérim — fort.
- Autonomie : portage — élevée.
- Rémunération : grille vs négociation (TJM).
| Élément | Intérim | Portage salarial |
|---|---|---|
| Lien | Subordination avec l’entreprise cliente | Pas de subordination opérationnelle |
| Rémunération | Selon grille interne | Negotiable (TJM) |
| Contrats | Contrat de mission + mise à disposition | Contrat de travail + contrat commercial |
| Avantages | Accès aux avantages d’entreprise et prime de précarité | Protection sociale via la société, pas d’accès systématique aux avantages |
Pour en savoir plus sur la mise en œuvre du portage, consultez notre guide pratique : trouver un portage salarial.
Avantages et inconvénients selon le profil et l’objectif
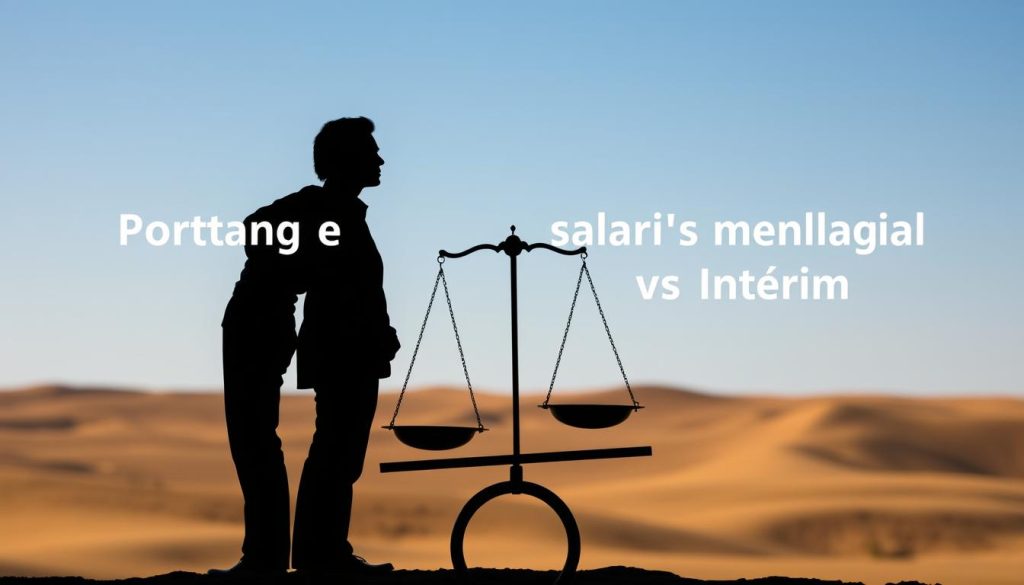
Le bon choix se fait selon le niveau d’expertise nécessaire et l’autonomie attendue.
Pour les entreprises clientes
Avantages : les agences gèrent le recrutement et l’administratif. Vous accédez à un vivier large et pouvez interrompre un contrat rapidement selon les cas.
Inconvénients : certains profils experts sont moins disponibles. Le coût global varie et doit être comparé à une prestation en portage.
Pour les travailleurs
Intérimaire : flexible, avec prime de précarité et possibilités de CDI. L’inconvénient principal reste une visibilité réduite et une autonomie limitée.
Salarié porté : autonomie commerciale, protection sociale du salarié et rémunération liée à l’expertise. En contrepartie, il faut prospecter et atteindre un seuil de chiffre d’affaires.
| Profil | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Entreprise cliente | Recrutement externalisé, vivier, flexibilité | Coût variable, accès limité aux experts pour certains cas |
| Travailleur – intérimaire | Intégration aux avantages d’entreprise, prime, passerelles CDI | Visibilité faible, autonomie restreinte |
| Travailleur – salarié porté | Autonomie, protection sociale, meilleur alignement tarif/expertise | Prospection nécessaire, seuils de facturation à atteindre |
« Choisissez selon votre appétence pour la prospection et la nature d’expertise attendue par les entreprises. »
Coûts, frais de gestion et impacts sur la rémunération
Les choix de facturation et de gestion influent directement sur le net que vous percevez et sur le coût réel pour l’entreprise.
Frais de gestion en portage salarial typiquement varient de 5 à 10% du chiffre d’affaires. Certaines société proposent un forfait mensuel (ex. à partir de 99€/mois) qui facilite la prévisibilité des frais.
Pour dégager un salaire net cohérent, projetez un seuil de facturation qui couvre le salaire, les charges et les frais de gestion. La société assure la paie, la comptabilité et le suivi juridique.
Du côté du travail temporaire, l’entreprise supporte une marge agence qui augmente le coût global. Le salarié perçoit, en fin de mission, une prime de précarité d’environ 10% et bénéficie de l’égalité de traitement sur le salaire et les avantages.
Le choix du contrat (CDD, CDI avec la société, ou CDII en travail temporaire) modifie la visibilité du revenu et l’équilibre entre flexibilité et stabilité.
Pour un comparatif détaillé et chiffré sur les scénarios CDI vs prestation, consultez notre guide comparatif portage salarial et cdi.
Quand choisir l’intérim, quand préférer le portage ?
Pour décider, confrontez la durée prévue, le niveau d’expertise requis et la nature opérationnelle de la mission.
Missions techniques, saisonnières ou de remplacement : l’intérim en priorité
Choisissez l’intérim pour des missions courtes, techniques ou de remplacement. La formule assure une mise en mission rapide et une gestion administrative par l’agence.
Elle convient aux activités manuelles, aux pics saisonniers et aux besoins où la présence sur site est essentielle.
Prestations intellectuelles, conseil et profils expérimentés : le portage à privilégier
Privilégiez le portage salarial si la valeur tient à l’expertise, au livrable et à l’autonomie du professionnel.
Cette voie est idéale pour le conseil, la conduite de projet ou le management de transition. Le salarié porté négocie son tarif et peut opter pour un CDI pour plus de continuité.
Cas limites et contraintes légales
Vérifiez les exclusions d’activité (services à la personne, BTP) et le niveau de qualification requis. Si l’activité se trouve proche des exclusions, l’intérim reste souvent la solution prudente.
Du côté de l’entreprise cliente, interrogez la disponibilité du marché : les profils cadres sont parfois plus accessibles via le portage.
- Conseil pratique : formalisez la fiche de mission, les jalons et le cadre contractuel dès le départ.
Pour approfondir, consultez notre guide complet.
Conclusion
La sélection du bon statut repose sur l’équilibre entre rapidité de mise en place, contrôle managérial et valeur ajoutée attendue.
En synthèse, l’intérim offre un contrat cadré, l’égalité de traitement et une prime de précarité. Il convient aux besoins de remplacement ou aux pics d’activité.
Le portage salarial privilégie l’autonomie, la négociation tarifaire et les missions intellectuelles jusqu’à 36 mois. Il demande de la prospection et une organisation financière anticipée.
Pour une entreprise, l’arbitrage tient au besoin : renfort rapide versus mission d’expertise orientée résultats. Pour le salarié, choisissez selon votre appétence pour la prospection et la stabilité souhaitée.
Conseil pratique : formalisez vos objectifs et sécurisez la relation par un contrat clair (clauses, durée, livrables, gouvernance). Ainsi, l’option optimale aligne durablement besoins de l’entreprise et aspirations du salarié porté.
FAQ
Quelles sont les distinctions fondamentales entre portage salarial et intérim ?
Le portage salarial vous place en statut de salarié porté rattaché à une société de portage qui facture la mission et vous reverse un salaire après frais de gestion. L’intérim repose sur un contrat de mission par une agence de travail temporaire : le travailleur intérimaire est salarié de l’agence mais placé sous la direction de l’entreprise cliente. Les modalités de contrat, le degré d’autonomie et la nature des prestations diffèrent nettement.
Qui signe quel contrat dans chaque configuration ?
En intérim, l’agence signe un contrat de mission avec l’entreprise cliente et un contrat de travail (CDD ou CDII) avec l’intérimaire. En portage, la société de portage signe une convention commerciale avec l’entreprise cliente et un contrat de travail (généralement CDI ou CDD) avec le salarié porté, tandis que la mission est conclue par une lettre de mission.
Quel est le niveau d’autonomie du travailleur dans les deux statuts ?
Le salarié porté conserve une autonomie importante sur l’organisation de son activité et la négociation de ses prestations. L’intérimaire reste soumis au lien de subordination envers l’entreprise cliente pendant la mission et exécute des tâches sous la hiérarchie de l’encadrement interne.
Comment se calcule la rémunération et quel impact ont les frais ?
En portage, la société prélève des frais de gestion (pour la facturation, la paie, la protection sociale) puis verse un salaire net. Le salarié porté négocie son taux journalier. En intérim, l’agence applique une marge, paie l’intérimaire selon une grille et la mission peut ouvrir droit à une prime de précarité à la fin d’un CDD, selon la durée et le type de contrat.
Quels sont les avantages sociaux et protections pour chaque statut ?
Les deux statuts donnent droit à la protection sociale (santé, retraite, chômage selon conditions). Le salarié porté bénéficie souvent d’une protection sociale complète et d’une autonomie commerciale ; l’intérimaire a les protections liées au contrat de travail mais peut subir une moindre visibilité à long terme et dépend de la mission.
Quelles activités sont éligibles au portage salarial ou à l’intérim ?
Le portage convient surtout aux prestations intellectuelles, missions de conseil ou expertise. L’intérim cible souvent des missions techniques, saisonnières, ou des remplacements opérationnels. Certaines activités réglementées peuvent être exclues du portage ou de l’intérim; il convient de vérifier au cas par cas.
Quelle est la durée maximale des missions et les limites légales ?
Les règles varient : en intérim, un contrat de mission est limité dans le temps et encadré par des durées maximales selon l’usage et la loi (renouvellements possibles). En portage, la relation salariale peut être en CDI ou CDD ; les missions facturées peuvent durer plus longuement mais doivent respecter les règles applicables aux CDD et aux contrats commerciaux.
Pour une entreprise cliente, quels bénéfices offre chaque solution ?
L’intérim offre une grande réactivité pour remplacer ou augmenter rapidement les équipes et un contrôle managérial direct. Le portage donne accès à des profils experts, une externalisation administrative et une souplesse pour des prestations intellectuelles sans lien de subordination marqué.
Quels inconvénients pour le travailleur dans chaque cas ?
L’intérimaire peut subir une précarité de missions et une visibilité limitée sur l’emploi long terme. Le salarié porté doit assurer la prospection commerciale et accepte des frais de gestion qui diminuent la marge brute, mais gagne en autonomie et protection sociale.
Comment comparer les coûts pour l’entreprise entre intérim et portage ?
L’intérim implique une marge agence et des coûts liés à la gestion des remplacements. Le portage facture la prestation avec un tarif qui intègre les services de la société de portage. Il faut comparer le taux journalier facturé, les frais annexes et la valeur ajoutée (expertise, rapidité de mise en place).
Dans quels cas privilégier l’intérim plutôt que le portage ?
Privilégiez l’intérim pour des missions d’exécution, saisonnières, de remplacement ou quand l’entreprise a besoin d’un contrôle opérationnel strict et d’une intégration rapide au sein des équipes.
Quand le portage est-il la meilleure option ?
Le portage est adapté aux consultants, experts et cadres qui vendent une prestation intellectuelle, souhaitent la sécurité d’un statut salarié et veulent externaliser la facturation et la gestion administrative tout en gardant de l’autonomie.
Le portage salarial ou l’intérim permettent-ils d’accéder à un CDI dans l’entreprise cliente ?
L’intérim est souvent un tremplin vers un CDI pour les intérimaires qui conviennent au poste. Le salarié porté peut conclure une relation durable avec un client, mais la transition vers un CDI dépendra d’un recrutement direct et des besoins de l’entreprise cliente.
Quels sont les éléments à vérifier avant de choisir une société de portage ou une agence d’intérim ?
Vérifiez la réputation, la transparence des frais de gestion, la qualité du support administratif, la conformité juridique, les garanties sociales et la capacité à vous placer sur des missions correspondant à votre profil et vos objectifs.





