Près d’un professionnel sur cinq choisit une solution hybride pour démarrer sa mission : garder la protection sociale du salarié tout en travaillant en toute autonomie.
Nous cadrons d’emblée une présentation structurée pour vous aider à choisir. Ce guide compare clairement les avantages et les contraintes de chaque voie selon votre projet, votre appétence au risque et vos objectifs.
Le statut hybride apporte congés payés, assurance chômage, mutuelle, retraite et un salaire mensuel sécurisé. Il convient surtout aux prestations à forte expertise et nécessite un TJ conseillé autour de 250–300 € HT.
La micro-entreprise offre des démarches simplifiées et des charges allégées, mais impose des plafonds de chiffre d’affaires (ex. 33 200 € ou 70 000 € selon l’activité) et une franchise de TVA.
Nous expliquons aussi les coûts réels (commissions ≈10 %, charges 40–45 %), l’impact sur la trésorerie, et la crédibilité commerciale pour accéder au crédit.
Pour un aperçu détaillé et des exemples chiffrés, consultez notre article dédié sur le sujet ici.
Table of Contents
Points clés à retenir
- Le choix dépend du niveau d’expertise, du besoin de protection sociale et du souhait d’autonomie.
- Le système hybride garantit un salaire mensuel mais implique des commissions et charges.
- La micro-entreprise simplifie la gestion mais limite le chiffre d’affaires.
- Vérifiez l’éligibilité de votre activité : certaines professions réglementées sont exclues.
- Anticipez la trésorerie : délais de paiement et accès au crédit diffèrent selon le statut.
Introduction au sujet et intention de recherche
Ce chapitre pose le cadre et précise l’intention pour orienter votre choix pratique.
Objectif : vous fournir une vue d’ensemble fiable pour choisir entre portage salarial et lancement d’une entreprise.
Le portage attire ceux qui veulent garder la protection d’un salarié tout en gagnant en indépendance. Il repose sur une relation tripartite et trois contrats. Cette formule vise surtout les prestations de services à forte valeur.
Les alternatives incluent la micro-entreprise, l’EI/EURL (TNS) et la SASU (assimilé-salarié). Chaque option diffère selon la nature de l’activité, le chiffre d’affaires visé et la gestion administrative que vous acceptez.
Ce que vous allez trouver ici :
- Des repères budgétaires et administratifs pour anticiper les coûts.
- Les différences de protection sociale liées au statut choisi.
- Les impacts pratiques sur la négociation commerciale, la facturation et le suivi des paiements.
Notre promesse : un cadre d’évaluation clair. Vous saurez rapidement si commencer en portage puis évoluer vers la création est pertinent pour votre projet et votre travail quotidien.
Définitions, périmètre et fonctionnement des deux options
Qu’est-ce que le portage salarial ?
Commençons par décrire précisément les statuts et leur périmètre d’application.
Le portage salarial combine autonomie commerciale et statut de salarié régi par le code travail. Le professionnel prospecte ses clients, tandis que la société portage facture et reçoit les paiements.
La relation se formalise par trois documents : la convention d’adhésion, le contrat travail entre le porté et la société, puis le contrat prestation entre la société et le client. Ces contrats sécurisent la mission et clarifient les responsabilités.
Créer son entreprise : formes et impacts
Pour la création, plusieurs véhicules existent. La micro-entreprise offre simplicité et franchises, mais fixe des plafonds de chiffre d’affaires.
L’EI/EURL relève du régime TNS, avec une protection sociale moindre. La SASU propose un statut assimilé-salarié et une protection proche du salarié.
- Accès au portage : qualification exigée (Bac+2 ou 3 ans d’expérience).
- Rôle de la société : employeur administratif, gestionnaire de facturation et partenaire opérationnel.
Ces cadres influencent vos cotisations, vos droits sociaux et votre marge de manœuvre. Pour un tour d’horizon des avantages, consultez notre article sur les bénéfices du portage salarial.
Activités éligibles et exclusions : prestations de services, niveaux d’expertise et cas limites
Voici un panorama pratique des missions et secteurs compatibles, ainsi que des limites à connaître.
Le dispositif vise surtout des prestation services à haute valeur : conseil digital, data, UX/UI, ressources humaines, finance, contrôle de gestion, DAF à temps partagé et management de transition.
Le niveau attendu : typiquement Bac+2 ou au moins trois ans d’expérience dans la spécialité. Ces conditions sécurisent l’accès et la contractualisation.
Secteurs compatibles et exclusions
- Domaines éligibles : conseil web, BI, RH, finance, pilotage de projets.
- Exclusions : professions réglementées et services personne qui demandent une immatriculation en nom propre.
- Cas limites : métiers artisanaux ou commerciaux souvent non adaptés et nécessitent un statut d’entrepreneur.
| Statut adapté | Exemples de missions | Pourquoi |
|---|---|---|
| Eligible | Audit data, DAF temps partagé, management de transition | Prestations intellectuelles, facturation facile |
| Non adapté | Services personne, professions réglementées, commerce de détail | Réglementation, besoin d’immatriculation |
| Cas limite | Consultant commercial, artisan multi-activités | Vérifier contrat client et conformité |
Pour trancher rapidement, nous conseillons d’analyser la fiche mission et de consulter un spécialiste. Pour un point précis sur le contrat de prestation, consultez notre article dédié sur le contrat de prestation.
Protection sociale, sécurité et droits associés
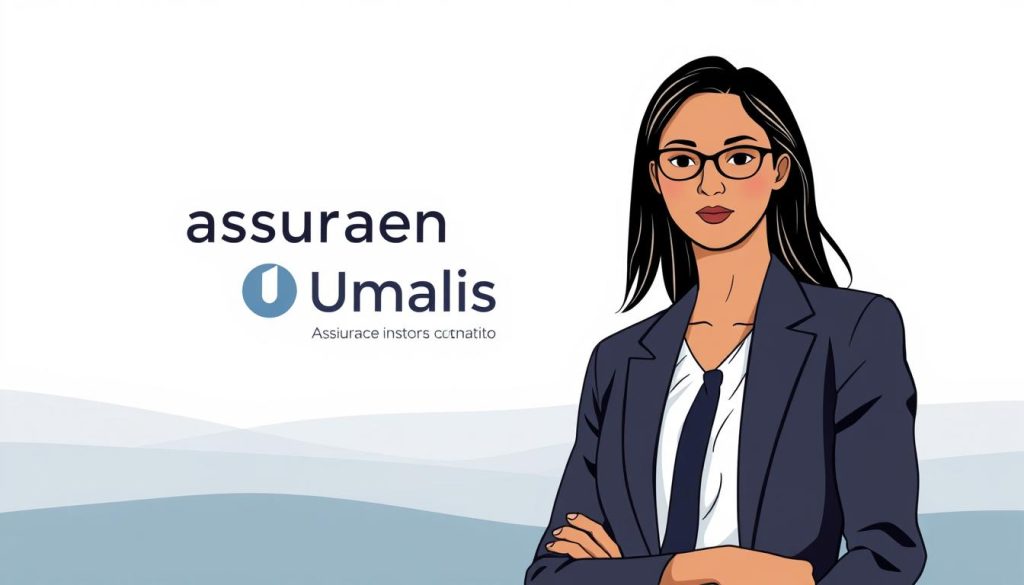
La sécurité sociale et les droits associés pèsent lourd dans la décision professionnelle. Nous détaillons ici les garanties concrètes et les implications pour votre trésorerie et vos démarches.
Assurance chômage, congés payés, mutuelle et stabilité du salaire
En portage salarial, le salarié conserve des droits complets : congés payés, assurance chômage, mutuelle et prévoyance. Ce cadre ouvre un niveau de sécurité proche d’un contrat salarié classique.
Le versement d’un salaire mensuel stabilise la trésorerie. Vous dépendez moins des délais de paiement client.
Retraite et cotisations : salarié porté vs TNS vs assimilé-salarié
Le régime TNS (EI/EURL) propose des cotisations réduites mais une protection moindre, notamment pour la retraite et l’assurance. L’assimilé-salarié (SASU) offre une protection proche du salarié, sans droit automatique au chômage.
Comparez les cotisations et l’étendue des droits pour choisir selon votre profil et vos priorités.
Niveau de sécurité juridique et accès au crédit
Le statut de salarié rassure souvent les banques. Un contrat et des bulletins de salaire facilitent l’accès au crédit immobilier ou professionnel.
Nous recommandons de documenter systématiquement vos droits : contrats, fiches de paie et attestations d’assurance. Cela optimise l’obtention de financements et clarifie vos obligations légales.
- Avantages sociaux : congés, assurance, mutuelle, retraite.
- Stabilité : salaire mensuel réduit le risque de trésorerie.
- Crédit : statut salarié facilite les demandes bancaires.
Coûts, charges sociales et rémunération nette
Avant de choisir, quantifions l’impact des commissions et des cotisations sur votre net.
Commission, cotisations et effet sur la rémunération
En portage salarial, la société retient en moyenne ≈10 % de commission puis des charges totales autour de 40–45 %. Ces charges sociales et cotisations réduisent la part disponible pour votre rémunération.
| Poste | Proportion | Effet |
|---|---|---|
| Commission société portage | ~10 % | Frais de gestion et services |
| Cotisations sociales | 40–45 % | Protection sociale et retraite |
| Rémunération nette estimée | reste après charges | variable selon TJM |
Taux journalier conseillé
Pour couvrir commissions, cotisations sociales et frais, un TJM de 250–300 € HT est recommandé. Un TJM inférieur pèse fortement sur le salaire et la soutenabilité.
Micro-entreprise : charges allégées, limites claires
La micro-entreprise réduit certaines charges et simplifie la gestion, mais le plafond de chiffre affaires (ex. 33 200 € ou 70 000 € selon l’activité) freine la croissance.
Mini-canevas : (TJM HT x jours facturables) – commissions – cotisations = rémunération nette approximative.
Gestion administrative, contrats et relation client
La façon dont sont gérées les obligations comptables influe sur votre temps et votre trésorerie.
Qui gère quoi ?
En portage salarial, la société portage facture le client, suit la comptabilité et prend en charge le recouvrement des impayés.
Cela signifie que vous conservez la prospection, la négociation du contrat et le pilotage de la mission, sans la charge administrative.
En création d’entreprise, la facturation est à votre nom. Vous gérez devis, relances et avancez la trésorerie en cas de délais longs.
Crédibilité commerciale, délais et cadre contractuel
Avantages concrets : la société fournit souvent des outils marketing, un réseau et une assurance RC professionnelle.
Le versement d’un salaire dès le premier mois réduit le risque de tension lié aux délais de paiement.
Un contrat clair sécurise le périmètre des missions, les livrables et les conditions de paiement. Nous recommandons d’exiger des clauses sur les délais, pénalités et propriété intellectuelle.
| Élément | Société portage | Création d’entreprise |
|---|---|---|
| Facturation | Gérée par la société | À votre nom |
| Comptabilité & recouvrement | Pris en charge | Vous gérez |
| Crédibilité commerciale | Renforcée par la société | Construite par vos moyens |
| Trésorerie | Salaire versé rapidement | Exposé aux délais client |
| Assurance & outils | Souvent inclus | À souscrire et financer |
Pour structurer vos process et ouvrir un compte dédié, suivez nos conseils pratiques sur trouver une solution adaptée. Cela facilite les relations avec des clients grands comptes et réduit les impayés.
Chiffre d’affaires, seuils et viabilité financière
La rentabilité d’un projet indépendant se juge à partir d’un scénario de chiffre d’affaires réaliste. En portage salarial, un TJM conseillé de 250–300 € HT devient souvent la base pour dégager une rémunération viable.
Avec un taux d’occupation courant de 120 à 160 jours facturables, vous pouvez estimer un CA annuel et vérifier si le net couvre vos charges personnelles.
Plafonds, régime et effets de seuil
Pour la micro-entreprise, les références sont claires : franchise de TVA souvent à 33 200 € et plafond de régime à 70 000 € pour les services. Dépasser ces seuils entraîne la sortie de la franchise, la gestion de la TVA et une comptabilité plus lourde.
| Paramètre | Repère | Conséquence |
|---|---|---|
| TJM conseillé | 250–300 € HT | Viabilité en portage |
| Jours facturables | 120–160 | Estimation CA annuel |
| Seuil micro | 33 200 / 70 000 € | Franchise TVA / bascule de régime |
Conseil pratique : suivez un compte d’exploitation simple chaque mois. Testez trois scénarios (bas, moyen, haut) pour anticiper besoins de trésorerie, points de bascule et le moment opportun pour changer de statut.
Comparaison entre portage salarial et création d’entreprise

Ici nous mettons en regard les choix opérationnels et financiers pour éclairer votre décision.
Flexibilité opérationnelle, autonomie et conditions de développement
Liberté commerciale : vous gardez la maîtrise de vos missions et du travail. En création d’entreprise, l’entrepreneur peut recruter, s’associer et investir pour croître.
La solution en portage offre moins de leviers de développement (pas de recrutement direct), mais fournit des outils marketing et un réseau utiles pour décrocher des contrats grands comptes.
Risque, responsabilité et sécurité de l’activité professionnelle
Sécurité : le statut porté réduit l’exposition personnelle aux impayés et aux formalités. En création, vous assumez davantage la responsabilité juridique et financière.
Accompagnement, formation, réseau et assurance responsabilité professionnelle
Atouts concrets : formation, assurance RC professionnelle et recouvrement sont souvent inclus chez la société. Cela facilite la gestion quotidienne des services fournis.
Compte bancaire professionnel, gestion et obligations courantes
En micro, un compte dédié est obligatoire pour séparer les flux. La société prend en charge la facturation et le suivi, allégeant votre charge administrative.
Compatibilité et cumul des statuts selon les missions
Le cumul peut être pertinent : facturer certains clients via la société pour viser des ETI/GE, et d’autres en micro pour limiter les coûts. Nous recommandons d’évaluer le régime fiscal et la viabilité selon vos activités.
- Synthèse rapide : statut, accompagnement, sécurité et potentiel de croissance doivent être pondérés selon vos missions.
- Pour un guide pratique et des cas chiffrés, consultez notre comparatif portage vs freelance.
Cas pratiques et critères pour choisir entre les deux statuts
Voici des repères opérationnels pour décider en fonction de votre marché et de vos objectifs.
Niveau de chiffre d’affaires et qualification
Si vous visez un chiffre affaires élevé (TJM 250–300 € HT, 120–160 jours facturables), le portage salarial offre une protection utile. Le profil type : Bac+2 ou 3 ans d’expérience pour sécuriser l’éligibilité.
Nature des prestations
Pour des prestations à forte valeur avec frais déductibles, le portage facilite la facturation et la protection sociale.
Pour interventions simples, sans frais, la micro ou la création entreprise peut suffire, sous réserve des plafonds de CA et de la franchise TVA.
Objectifs de croissance, recrutement et investissements
Si vous prévoyez de recruter, d’associer ou d’investir, créer entreprise devient souvent plus pertinent. La structure permet d’embaucher, de lever des fonds et de déployer des outils.
- Scénario 1 : CA modéré, mission isolée → micro ou portage selon protection souhaitée.
- Scénario 2 : CA élevé, recrutement prévu → créer entreprise pour croître.
- Scénario 3 : début sécurisé → démarrer en portage, puis basculer vers entreprise.
« Calibrez votre TJM et testez un mini-prévisionnel : revenus, charges, marge et pipeline. »
Checklist décisionnelle : activité, qualification, pipeline clients, CA cible, marge, appétence au risque. Remplissez un mini-prévisionnel simple pour trancher sereinement.
Conclusion
Pour clore ce guide, retenez l’essentiel : le portage salarial offre une protection sociale complète (chômage, congés, mutuelle) et un salaire mensuel. Il supporte des coûts réels : commission ≈10 % et charges autour de 40–45 %.
La création entreprise donne la liberté d’investir, recruter et structurer une croissance. La micro conserve la simplicité, mais impose des plafonds de chiffre d’affaires et la franchise de TVA.
Le cumul des statuts reste une option pratique pour arbitrer selon les missions, les frais et les seuils. Calculez un prévisionnel simple pour valider votre choix.
Si vous souhaitez savoir plus, formaliser un prévisionnel ou documenter votre process, nous pouvons vous accompagner. Pour savoir plus, consultez nos ressources et contactez un conseiller pour avancer sereinement. Savoir plus aide chaque entrepreneur à sécuriser son travail et son statut.
FAQ
Qu’est-ce que le portage salarial et comment il est encadré par le Code du travail ?
Le portage salarial est un dispositif où un professionnel réalise des missions pour des clients tout en étant salarié d’une société de portage. Le Code du travail définit la relation tripartite : la société de portage facture le client, verse un salaire au porté et gère les cotisations sociales. La convention collective et la société de portage précisent les conditions (convention d’adhésion, contrat de travail ou contrat à durée déterminée d’usage selon le cas).
Quand créer une micro-entreprise, une EURL ou une SASU plutôt que d’opter pour le portage ?
La création d’une micro-entreprise ou d’une société unipersonnelle (EI, EURL, SASU) convient si vous voulez maîtriser vos frais, développer une activité à long terme, facturer des prestations réglementées ou employer. Le statut choisi dépend du niveau de chiffre d’affaires attendu, des besoins en protection sociale et du souhait d’optimisation fiscale. La micro-entreprise offre des charges simplifiées mais des plafonds et moins de protection sociale.
Quelles activités sont éligibles au portage et quelles professions sont exclues ?
Le portage convient surtout aux prestations intellectuelles : conseil, IT, gestion, RH, finance, management, formation. Certaines professions réglementées ou relevant des services à la personne peuvent être exclues ou nécessiter des conditions spécifiques. Pour ces cas, créer une société reste souvent la solution adaptée.
Comment fonctionne la relation tripartite en portage salarial ?
La relation tripartite réunit le porté, la société de portage et le client. Elle repose sur une convention d’adhésion signée par le porté, un contrat de prestation entre la société de portage et le client, et un contrat de travail (CDI/CDD/contrat d’usage) liant le porté à la société de portage. La société se charge de la facturation, de la paie et des obligations sociales.
Quelle protection sociale et quels droits offre le statut salarié porté ?
Le salarié porté bénéficie de la sécurité sociale, de l’assurance chômage (si conditions remplies), des congés payés et d’une mutuelle collective selon la société de portage. Sa retraite est assimilée-salarié, avec cotisations redistribuées. Ce niveau de protection est généralement supérieur à celui d’un travailleur non salarié (TNS).
Quelle différence de cotisations et de rémunération nette entre portage et entreprise individuelle ?
En portage, les charges globales (commissions + cotisations sociales) peuvent représenter 40-55 % du chiffre d’affaires selon la société. La commission de gestion tourne souvent autour de 5-15 %. En micro-entreprise, les cotisations sont allégées mais la protection sociale est moindre et il existe des plafonds de chiffre d’affaires. Le choix dépend du niveau de revenus visé et de la priorité entre protection et optimisation.
Quel taux journalier minimum viser pour que le portage soit viable ?
Un taux journalier de 250–300 € HT est souvent indiqué comme seuil pour assurer une rémunération nette intéressante après déduction des frais, cotisations et commission de la société de portage. Ce seuil varie selon les charges fixes et le volume de missions.
Qui gère la facturation, la comptabilité et le recouvrement selon chaque statut ?
En portage, la société de portage gère la facturation, la trésorerie, la paie et le recouvrement. En entreprise individuelle ou société, l’entrepreneur prend en charge (ou externalise) la facturation, la comptabilité et le recouvrement ; la responsabilité juridique et financière lui incombe.
Quel impact sur l’accès au crédit et la crédibilité commerciale ?
Le statut salarié porté offre une fiche de paie régulière, facilitant l’accès au crédit. Une société bien structurée (SASU, EURL) améliore la crédibilité vis‑à‑vis des partenaires et des grands comptes. La micro-entreprise peut paraître moins solide pour des contrats importants.
Quels sont les plafonds et seuils à connaître en micro-entreprise ?
La micro-entreprise est soumise à des seuils de chiffre d’affaires qui déclenchent la franchise de TVA ou le changement de régime fiscal. Ces plafonds diffèrent selon l’activité (services ou commerce). Dépasser ces seuils peut entraîner l’obligation de basculer vers un régime réel et modifier les charges.
Peut-on cumuler le statut de salarié porté avec d’autres activités ou statuts ?
Le cumul est possible sous conditions : vérifier les clauses contractuelles (non-concurrence, exclusivité) et la compatibilité avec d’autres statuts (salarié, micro-entrepreneur). La transparence avec la société de portage et les clients est essentielle pour éviter des conflits juridiques.
Comment choisir entre sécurité (portage) et autonomie (création d’entreprise) selon son projet ?
Évaluez votre niveau de chiffre d’affaires prévisionnel, votre besoin de protection sociale, votre appétence pour la gestion administrative et vos objectifs de croissance. Le portage privilégie la sécurité et la simplicité ; la création offre plus d’autonomie, d’optimisation et d’évolutivité si vous prévoyez d’embaucher ou d’investir.
Quelles assurances et garanties sont recommandées pour exercer ?
Que vous soyez porté ou entrepreneur, souscrivez une assurance responsabilité civile professionnelle, une mutuelle adaptée et, selon l’activité, des garanties complémentaires (prévoyance, protection juridique). Ces protections sécurisent l’activité et renforcent la confiance client.
Le portage salarial convient-il pour des missions internationales ?
Oui, sous réserve des règles fiscales et sociales applicables à chaque pays. La société de portage doit pouvoir gérer les particularités transfrontalières ou proposer des solutions adaptées. Il est essentiel de valider le cadre juridique et la couverture sociale avant d’accepter une mission à l’étranger.
Quels critères pratiques pour décider rapidement du statut le mieux adapté ?
Considérez : montant attendu du CA, fréquence des missions, besoin de protection sociale, volonté d’embaucher, appétence pour la gestion administrative, exigences clients en matière de contrat. Pour tester un marché ou conserver une sécurité, le portage constitue souvent une bonne première étape.





