Le portage salarial combine autonomie et protection. Ce cadre tripartite lie un salarié porté, une entreprise qui l’emploie et une société cliente. Il offre une sécurité juridique régulée par l’ordonnance 2015-380 et la convention collective (IDCC 3219).
Ce guide explique pourquoi ce contrat est spécifique et à qui il s’adresse. Vous apprendrez à bâtir pas à pas un accord conforme, depuis la définition du besoin jusqu’au démarrage de la mission.
Avantages : alternative à la création d’entreprise, protection sociale du salarié, facturation simplifiée via l’entreprise portage salarial, tout en conservant l’autonomie professionnelle.
On présente aussi les limites légales (exclusion des services à la personne), les documents clés et les éléments financiers : honoraires, frais, salaire, cotisations et réserve financière. Pour aller plus loin, consultez ce guide pratique sur le contrat de prestation en portage.
Table of Contents
Points clés à retenir
- Relation tripartite garantissant un cadre juridique sécurisé.
- Trois documents indispensables : convention d’adhésion, contrat de travail, contrat commercial.
- Rémunération minimale encadrée par la convention collective.
- Exclusions à connaître : services à la personne.
- Vérifier clauses essentielles : durée, confidentialité, propriété intellectuelle.
Pourquoi choisir le portage salarial pour vos prestations
Le portage salarial permet d’exercer en autonomie tout en conservant un statut salarié sécurisé. Il évite les démarches d’immatriculation et facilite le lancement d’une activité de conseil.
Alternative pragmatique à la création d’entreprise
Tester une activité devient simple : la société portage embauche le consultant, facture la mission et verse un salaire au salarié porté. Ainsi, l’entrepreneur démarre vite sans gérer la facturation ni la paie.
Quand c’est utile pour l’entreprise cliente
Pour une mission ponctuelle, un projet court ou une expertise rare, le recours est pertinent et conforme à l’article L.1254-3 du Code du travail.
- Sécurité : bulletin de paie, cotisations sociales, assurance chômage et retraite.
- Flexibilité : durée modulable et visibilité sur le coût via un contrat clair (avantages du portage salarial).
- Économie d’administration : la société portage prend en charge facturation et déclarations.
Limite : ce mode n’est pas adapté aux activités réglementées ni aux besoins permanents de recrutement.
Comprendre la relation tripartite: salarié porté, entreprise de portage, entreprise cliente
La mise en œuvre du portage repose sur des rôles clairs entre le consultant, la société qui l’emploie et le client. Cette relation organise qui négocie, facture et reçoit les livrables.
Rôles et responsabilités
Salarié porté : négocie la mission, réalise le travail et délivre les livrables. Il doit justifier d’une expertise et d’une autonomie suffisantes.
Entreprise portage : embauche le consultant en contrat travail (CDD ou CDI), facture le client et verse le salaire.
Entreprise cliente : commande la mission, reçoit et valide les livrables. Le recours doit rester ponctuel ou lié à une expertise externe.

Cadre juridique et exclusions
Le cadre repose sur l’ordonnance 2015-380 et la loi de 2016, complété par la convention collective. Le droit précise aussi les règles propres au CDD : terme ou durée minimale, deux renouvellements, 18 mois max et mentions écrites obligatoires.
Exclusions : les services à la personne sont interdits. Le non-respect expose à une amende prévue par le Code du travail.
| Acteur | Document principal | Responsabilité clé | Sanction en cas d’abus |
|---|---|---|---|
| Salarié porté | Contrat travail (CDD/CDI) | Réalisation et prospection | Risque professionnel, pas de salaire si pas de mission |
| Entreprise portage | Contrat commercial avec le client | Facturation et paie | Amende si activité illégale |
| Entreprise cliente | Bon de commande / accord commercial | Commande et réception | Amende si recours permanent |
Les trois documents clés à mettre en place avant la mission
Avant tout démarrage, trois documents structurent la collaboration entre le consultant, la société d’accompagnement et l’entreprise cliente. Ils définissent services, garanties et modalités pratiques pour garantir sécurité juridique.
Convention d’adhésion : cadre et services
La convention crée le lien juridique entre l’indépendant et la société. Elle précise les frais de gestion, le versement du salaire, la convention collective applicable et la couverture RC Pro.
Le contrat travail : CDD ou CDI
Le contrat travail contient les mentions légales, la période d’essai, le domaine d’activité, les modalités de rémunération, congés et visite médicale. En CDD, la durée déterminée doit être indiquée (max 18 mois, deux renouvellements). Le CDI conserve une souplesse différente.
Le document mission (tripartite)
Ce texte décrit le périmètre, la durée, les frais et les moyens alloués. Il intègre clauses sensibles : confidentialité, propriété intellectuelle et non‑sollicitation.
Ordre de signature et conseils
Signer d’abord la convention, puis le contrat travail et enfin le document mission. Vérifiez la cohérence des dates, des montants et annexes : cahier des charges, planning et liste des livrables.
Contrat de prestation en portage salarial: étapes pratiques pour le rédiger
Pour sécuriser une mission, chaque élément doit être formalisé avant le démarrage. Un document clair évite les ambiguïtés entre le salarié porté, l’entreprise qui accompagne et l’entreprise cliente.
Recueillir le besoin : définissez objectifs, contexte, livrables, contraintes et jalons. Traduisez ces éléments en critères mesurables pour valider la réussite.

Négocier organisation et durée : précisez site (sur place/distanciel), rythme, outils et interdépendances. Calibrez la durée et prévoyez des points de pilotage réguliers.
Honoraires et frais : fixez TJM ou forfait, listez frais remboursables et calendrier de facturation/versement. Indiquez pénalités de retard et modalités de paiement.
« Un document signé avant l’intervention protège les droits et clarifie les responsabilités. »
- Inclure clauses sensibles : confidentialité, propriété intellectuelle, non‑sollicitation et conformité RGPD.
- Faire valider par l’entreprise qui gère le portage pour vérifier RC Pro, conformité juridique et alignement avec le contrat de travail.
- Organiser le démarrage : DPAE, mutuelle, accès aux outils et premier point de synchronisation.
Astuce pratique : pour un modèle et des conseils étape par étape, consultez nos conseils pour trouver un portage.
Clauses indispensables à intégrer dans le contrat de prestation
Un accord bien rédigé reprend point par point la nature de la mission, ses limites et les conséquences en cas de changement.
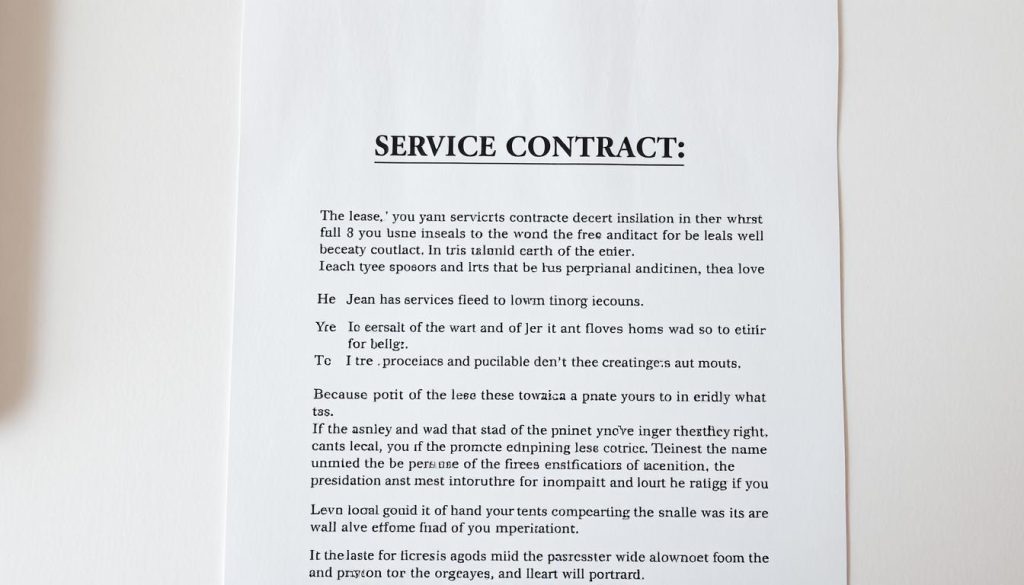
Description précise de la mission, durée et période
Rédigez une description exhaustive : objet, tâches incluses et exclues, livrables et jalons. Indiquez une durée et une période claires pour éviter toute ambiguïté.
Confidentialité, propriété intellectuelle et non‑sollicitation
Définissez le périmètre des informations protégées et la durée de l’obligation. Précisez la titularité des livrables, les cessions ou licences et le traitement des droits préexistants.
Encadrez la non‑sollicitation (salariés et clients) avec une durée raisonnable et des sanctions proportionnées.
Modalités de modification, suspension et fin de mission
Prévoyez une procédure de changement : demande écrite, estimation d’impact (coût/délai) et validation par avenant.
Anticipez la suspension (force majeure, indisponibilité) et ses effets sur facturation et reprise. Clarifiez les causes de fin, le préavis et la restitution des moyens.
| Thème | Ce qu’il faut prévoir |
|---|---|
| Modification | Demande écrite, devis, avenant |
| Suspension | Causes, impact durée/facturation |
| Fin | Préavis, indemnités, restitution |
Astuce : alignez ces clauses avec le contrat travail et la convention d’adhésion pour garantir un cadre cohérent entre le salarié, l’entreprise et l’entreprise cliente.
Choisir entre CDD et CDI de portage: impacts sur la mission
Selon l’objectif de la mission, le cadre choisi peut faciliter la continuité ou encadrer un projet précis.

Durées, renouvellements et risques
Le CDD fixe un terme ou une durée minimale. Il peut être renouvelé deux fois, pour une durée totale limitée à 18 mois.
Le contrat doit mentionner « portage salarial à durée déterminée » et être transmis sous 2 jours, conformément aux articles L.1254-11 à L.1254-17.
Le CDI n’a pas de terme. Il permet d’enchaîner des missions auprès d’une ou plusieurs entreprises sans limite fixée par ce cadre légal.
Rupture et période d’essai
En CDD la fin intervient au terme prévu. En CDI, la rupture obéit au droit commun : période d’essai, démission, rupture conventionnelle ou licenciement.
« Un choix adapté évite le risque de requalification et protège le salarié comme l’entreprise. »
- Conseil : privilégier le CDD pour un projet borné ; choisir le CDI pour de la continuité entre missions.
- Pensez aux effets sur la rémunération, la facturation mensuelle et la couverture sociale entre missions.
Rémunération du salarié porté, frais et cotisations sociales
La répartition des honoraires, des frais et des cotisations conditionne le net perçu chaque mois. Ce volet financier doit être clair dès la signature pour éviter les incompréhensions entre le salarié porté, la société portage et l’entreprise cliente.

Seuils minimums, réserve financière et indemnité d’apport d’affaires
À défaut d’accord de branche étendu, le salaire minimum légal est fixé à 75 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. La convention collective du 22 mars 2017 impose un revenu minimal brut à 77 % du même plafond, incluant la réserve financière.
Lorsque le salarié apporte lui‑même la mission, une indemnité d’apport d’affaires de 5 % s’ajoute à la rémunération si aucun accord spécifique n’existe.
Frais de gestion, frais professionnels et net à payer
La mécanique : la société facture le client, déduit les frais de gestion, rembourse les frais professionnels justifiés, prélève les cotisations, puis calcule le net à verser. Les frais remboursables doivent être listés et accompagnés de pièces.
| Élément | Exemple simple (mois) |
|---|---|
| Facturation client | 6 000 € |
| Frais de gestion (20 %) | 1 200 € |
| Cotisations & charges | 2 000 € |
| Réserve + salaire net | 2 800 € |
Périodes sans prestation et impact sur le salaire
Les périodes sans mission ne sont généralement pas rémunérées. La réserve financière sert à lisser les revenus entre deux missions.
Conseil : tenir un compte d’activité mensuel permet de suivre encaissements, frais et versements. La société portage transmet ces éléments chaque mois pour piloter la trésorerie et anticiper les mois creux.
« Un compte d’activité clair offre visibilité et contrôle sur les flux financiers du salarié porté. »
Obligations de l’entreprise de portage salarial et conformité
La société qui accompagne le salarié doit respecter des règles strictes pour protéger les salaires et assurer la conformité légale.
Compte d’activité : la société portage ouvre et tient à jour un compte d’activité. Elle transmet chaque mois les mouvements au salarié, conformément à l’article L.1254-25 du Code du travail.
DPAE et déclaration : la DPAE est effectuée avant toute embauche. L’entreprise doit aussi déclarer son activité auprès de l’autorité administrative (L.1254-27) et fournir les informations sur ses dirigeants.

Garanties et assurances : une garantie financière protège le paiement des salaires et des cotisations (L.1254-26). La RC Pro couvre les risques liés aux missions et doit être souscrite par la société.
Convention collective : le cadre est fixé par la convention du 22 mars 2017 (IDCC 3219), qui précise rémunération minimale et réserve financière.
Les manquements entraînent des amendes et, en cas de récidive, des peines plus lourdes (L.1255-14). Un audit interne régulier aide les entreprises à vérifier contrats, procédures et assurances.
Pour un modèle et des conseils pratiques, consultez notre modèle complet.
Encadrer la relation opérationnelle avec l’entreprise cliente
Une gouvernance simple et définie évite l’apparition d’un lien de subordination et protège toutes les parties. Le salarié porté réalise la mission pour l’entreprise cliente tout en rendant compte de son activité à la société qui l’emploie.
Organisation du travail sans lien de subordination
Privilégiez des objectifs et des livrables précis plutôt que des instructions hiérarchiques quotidiennes.
La loi prévoit que la société intervenante n’est pas tenue de fournir du travail (C. trav., art. L.1254-2). Fixez donc des modalités claires d’exécution dans le contrat commercial.
Reporting, livrables et critères de réception
Définissez un plan de reporting proportionné : fréquence, format, indicateurs clés et canaux. Cela facilite les arbitrages rapides.
Établissez des critères de réception objectifs : conformité aux spécifications, tests d’acceptation, délais de revue et procédure d’acceptation ou de rejet.
- Points de contact : référent côté client et référent côté société, avec une procédure d’escalade.
- Accès et moyens : outils, habilitations SI et règles de sécurité à respecter pendant la mission.
- Compte d’activité : consignez temps, livrables et imprévus pour la facturation et la paie.
- Gestion des changements : toute demande d’évolution fait l’objet d’une évaluation d’impact et d’un avenant si nécessaire.
Veillez à une durée et un rythme soutenables : planifiez des jalons clairs pour garantir qualité et satisfaction de l’entreprise cliente.
| Élément | Ce qu’il faut définir | Impact |
|---|---|---|
| Organisation | Objectifs, livrables, absence d’instructions hiérarchiques | Préserve l’indépendance juridique |
| Reporting | Fréquence, format, KPIs | Visibilité et pilotage |
| Réception | Tests d’acceptation, délais, procédure | Clarté sur validation et facturation |
| Accès & moyens | Outils, habilitations, sécurité | Sécurité et conformité opérationnelle |
« Un cadre opérationnel clair facilite la collaboration et limite les litiges. »
Mettre fin à la mission ou au contrat de travail de portage
Savoir clôturer correctement une mission protège le consultant, la société qui l’emploie et l’entreprise cliente. La rupture du contrat commercial n’entraîne pas automatiquement la rupture du contrat travail (C. trav., art. L.1254-8).
Fin de mission vs fin du contrat
La fin de mission signifie l’achèvement des livrables et la réception par le client.
La fin du contrat travail reste indépendante : le salarié conserve ses droits tant que le lien d’emploi subsiste.
Cas de rupture en CDD et en CDI
En CDD à durée déterminée, la fin intervient au terme ou après la durée minimale. Toute rupture anticipée suit les règles de droit commun et peut ouvrir droit à une indemnité de fin de contrat.
En CDI, la rupture peut se produire pendant la période d’essai, via une rupture conventionnelle, une démission ou un licenciement. Les procédures et délais légaux s’appliquent.
- Prévoir des clauses de sortie : préavis, conditions de résiliation et obligations de restitution.
- Gérer l’après-mission : périodes sans prestation non rémunérées (L.1254-21), mobilisation possible de la réserve financière et prospection d’une nouvelle mission.
- Formaliser la clôture : procès‑verbal de réception, bilan, mise à jour du compte d’activité et solde des paiements pour le mois concerné.
Erreurs fréquentes à éviter lors de la mise en place du contrat
Quelques maladresses suffisent pour déclencher un litige ou une sanction. Vérifiez d’abord que le recours client respecte les cas autorisés (L.1254-3, L.1255-16).
Ne confondez pas fin de mission et fin du contrat. Sécurisez ces deux volets avec des dispositions claires et des dates cohérentes.
Évitez une description floue de la prestation. Un périmètre mal défini provoque des désaccords sur la facturation et les critères de réception.
Respectez les exclusions légales : proscrire les services à la personne, qui entraînent des sanctions (L.1254-5, L.1255-14).
- Anticipez les renouvellements en CDD : nombre et durée maximale.
- Ne négligez pas les clauses clés : confidentialité, propriété intellectuelle, non-sollicitation, modalités de modification.
- Vérifiez la conformité de la société portage : DPAE, garantie financière, RC Pro et tenue du compte d’activité.
- Calibrez les modalités financières : barème de frais, calendrier de facturation et gestion des retards.
« Coordonnez la convention d’adhésion, le contrat et le document mission pour éviter les contradictions. »
Conclusion
Pour conclure, retenez que ce cadre offre une balance entre protection sociale et liberté d’action.
Choisissez ce dispositif si vous voulez exercer votre activité avec la sécurité du salariat tout en gardant votre autonomie. Définissez le besoin, rédigez un accord précis et alignez la convention, le contrat de travail et le document mission.
Sur le plan juridique, vérifiez l’éligibilité des missions, les exclusions, la durée et la distinction claire entre fin de mission et fin du contrat. Sur le plan financier, respectez les minima, suivez le compte d’activité et anticipez les périodes sans mission.
Pour mieux connaître les droits du salarié porté, consultez notre fiche pratique sur les droits du salarié. Mettre en place une check‑list avant signature facilite la conformité et accélère le lancement de la mission.
FAQ
Quelles différences entre portage salarial et création d’entreprise ?
Le portage permet d’exercer une activité indépendante tout en conservant le statut salarié et la protection sociale. Contrairement à la création d’une société, il n’y a pas de gestion comptable propre ni de responsabilité entrepreneuriale directe. L’entreprise de portage prend en charge la facturation, les cotisations sociales et le versement du salaire.
Quand le portage est-il adapté pour une entreprise cliente ?
Le portage convient pour des missions ponctuelles ou des expertises rares où l’entreprise cliente veut limiter les risques administratifs. Il est pertinent pour des interventions d’appoint, des projets temporaires ou des études sans volonté d’embauche durable.
Qui fait quoi dans la relation tripartite ?
Le salarié porté réalise la mission et rend compte à l’entreprise cliente. La société de portage facture le client, collecte les paiements, gère les cotisations et rémunère le salarié porté. L’entreprise cliente encadre le travail mais ne peut exercer un lien de subordination direct.
Quelles règles du Code du travail encadrent ce cadre juridique ?
Le Code du travail définit le portage comme une forme d’organisation tripartite et fixe des règles sur la nature du contrat de travail, la rémunération, et l’absence de lien de subordination. Il protège aussi contre la requalification en contrat de travail salarié direct si le lien de subordination existe.
Quelles prestations sont exclues du portage ?
Les tâches relevant d’un contrat de travail classique, les activités commerciales permanentes pour le compte du client ou les missions nécessitant un encadrement hiérarchique constant sont à éviter. Certaines professions réglementées peuvent aussi être exclues selon la réglementation.
Quels sont les trois documents essentiels avant toute mission ?
Il faut signer la convention d’adhésion avec la société de portage, le contrat de travail (CDD ou CDI) liant le salarié porté à la société de portage, et le contrat commercial entre la société de portage et l’entreprise cliente qui précise la mission et les conditions financières.
À quoi sert la convention d’adhésion ?
La convention d’adhésion définit le cadre des services fournis par la société de portage, les obligations réciproques, les frais de gestion et les conditions de rupture. Elle formalise la relation administrative et garantit des services de support au porté.
CDD ou CDI : comment choisir pour le contrat de travail ?
Le choix dépend de la nature et de la durée des missions. Un CDI offre une sécurité maximale pour le porté, alors qu’un CDD reste adapté aux missions temporaires. Il faut aussi mesurer les risques de requalification en contrat de travail si le CDD est renouvelé de façon répétée.
Quel rôle joue le contrat commercial tripartite ?
Ce document formalise l’accord entre la société de portage et l’entreprise cliente : objet de la mission, durée, prix, modalités de paiement et responsabilité. Il sécurise la facturation et permet d’éviter les malentendus opérationnels.
Dans quel ordre signer ces documents ?
Idéalement, la convention d’adhésion et le contrat de travail doivent être en place avant le démarrage de la mission, puis le contrat commercial peut être finalisé. Cet ordre garantit la conformité administrative et le versement du salaire au porté.
Comment définir le périmètre d’une mission ?
Il faut lister les objectifs, livrables, délais et moyens. Une description claire limite les risques d’ambiguïté et facilite la facturation. Précisez également les modalités de reporting et d’acceptation des livrables.
Comment négocier la durée et l’organisation du travail ?
Discutez des délais, de la durée hebdomadaire, du lieu d’intervention et des outils fournis. Inscrivez ces éléments dans le contrat commercial pour éviter toute confusion et protéger chaque partie en cas de litige.
Comment sont calculés les honoraires et les frais de mission ?
Les honoraires se négocient entre le porté et l’entreprise cliente, puis la société de portage facture. Les frais professionnels remboursables doivent être détaillés et justifiés. La société de portage prélève des frais de gestion avant de verser le net au porté.
Que doit valider l’entreprise de portage avant le démarrage ?
Elle vérifie l’adéquation de la mission, la solvabilité du client, la conformité réglementaire et l’absence de conflit d’intérêts. Elle formalise ensuite la facturation et met en place le versement des rémunérations.
Quelles clauses indispensables intégrer dans le document de mission ?
Intégrez une description précise de la mission, la durée, les conditions financières, les règles de confidentialité, la propriété intellectuelle, la non-sollicitation et les modalités de modification ou de suspension.
Comment protéger la propriété intellectuelle ?
Prévoyez une clause détaillant la titularité des livrables, les droits d’exploitation et les éventuelles cessions limitées dans le temps ou géographiquement. Cela évite les conflits après la fin de la prestation.
Quelles modalités pour suspendre ou modifier une mission ?
Définissez les conditions de suspension (force majeure, manquement), les obligations de notification, les délais de correction et les conséquences financières. Inscrivez également les procédures de modification formelle du périmètre.
Quels risques liés au choix entre CDD et CDI ?
Un usage abusif du CDD peut entraîner une requalification en CDI par les tribunaux. Le CDI protège le salarié porté mais engage davantage la société de portage. Évaluez la répétition des missions et la continuité d’activité.
Quelles règles en cas de rupture : période d’essai, fin de terme ?
La période d’essai et les conditions de rupture doivent être clairement indiquées dans le contrat de travail. Pour un CDD, respectez les règles légales de fin de contrat ; pour un CDI, la rupture suit les procédures usuelles (licenciement, démission, rupture conventionnelle).
Comment est calculée la rémunération nette du porté ?
La rémunération nette dépend des honoraires facturés, des frais de gestion de la société de portage et des cotisations sociales. Les frais professionnels remboursables ne sont pas soumis à cotisations s’ils sont justifiés.
Qu’est-ce que la réserve financière et l’indemnité d’apport d’affaires ?
La réserve financière est une somme mise de côté pour couvrir les charges sociales ou litiges. L’indemnité d’apport d’affaires rémunère une mise en relation apportée par un tiers et doit être clairement cadrée dans les accords.
Comment sont gérés les jours sans prestation ?
Les périodes sans mission peuvent réduire la rémunération. Certaines sociétés de portage proposent des droits rechargeables ou un accompagnement commercial pour retrouver des missions. Les règles doivent figurer dans la convention d’adhésion.
Quelles obligations pour la société de portage ?
Elle doit tenir un compte d’activité, effectuer la DPAE, assurer les garanties financières, souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et respecter la convention collective applicable.
Quelles déclarations et sanctions en cas de non-conformité ?
La société de portage doit déclarer son activité et respecter les obligations sociales. En cas de manquement, elle s’expose à des sanctions administratives, redressements URSSAF ou requalification des relations de travail.
Comment organiser le travail sans créer un lien de subordination ?
Privilégiez une relation de coordination basée sur des objectifs et des livrables plutôt que sur des horaires imposés. Formalisez les moyens mis à disposition sans impliquer un encadrement hiérarchique direct.
Quels outils de reporting et critères de réception mettre en place ?
Définissez des livrables, des jalons, des indicateurs de qualité et un processus d’acceptation. Un bon reporting facilite la facturation et sécurise le paiement du porté.
Quelle différence entre fin de mission et fin de contrat de travail ?
La fin de mission concerne l’arrêt d’une mission ponctuelle entre le client et la société de portage. La fin du contrat de travail concerne le lien entre le salarié porté et la société de portage, qui peut perdurer si d’autres missions sont prévues.
Quels cas de rupture en CDD et en CDI ?
Le CDD prend fin à l’échéance prévue sauf faute grave ou accord. Le CDI peut se terminer par démission, licenciement, rupture conventionnelle ou accord mutuel. Les indemnités et procédures diffèrent selon le type de contrat.
Quelles erreurs fréquentes éviter lors de la mise en place ?
Ne négligez pas la rédaction précise des documents, évitez l’ambiguïté sur le périmètre, ne sous-estimez pas les obligations sociales et ne laissez pas de lien de subordination larvé. Vérifiez aussi la solvabilité du client avant démarrage.





